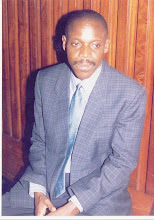Face à une Amérique en crise et à la panique qui règne sur les marchés financiers mondiaux, les gardiens du Temple de la Banque Centrale Européenne se veulent les garants d’une stabilité monétaire et d’un euro fort. Leur attitude s’inscrit en faux contre celle des dirigeants des deux économies les plus puissantes de l’Europe, à savoir la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, Nicolas Sarkozy, qui craignent que le maintien d’un Euro fort pourrait mener les économies européennes à la ruine. A leur inquiétude devrait faire écho, en théorie, le désarroi de leurs collègues des pays d’Afrique membres de la zone franc. En effet, leur monnaie, le franc CFA, étant ancrée à la monnaie européenne à un taux fixe surévalué, on est en droit de penser qu’ils ne pouvaient manquer de s’interroger sérieusement sur l’avenir, sinon sur le destin du franc CFA. Cette monnaie, dont la convertibilité fait les choux gras des spéculateurs, est une source majeure de perte de compétitivité, d’évasion de capitaux et de controverses quant à son rôle, supposé ou réel, dans la crise qui continue de plomber les économies des pays de la zone franc dans un contexte de turbulence économique, notamment financière, à l’échelle mondiale.
L’histoire du CFA est étroitement liée à celle de la colonisation des pays africains. Durant la période coloniale, Français et Anglais, deux des pays colonisateurs de la région, avaient mis respectivement sur pied la zone franc et le « board of currency » pour doter leurs empires africains d’un système monétaire unifié. Ce système était subordonné au franc français et à la livre sterling. Au lendemain de la proclamation des indépendances nationales à partir de la fin des années 1950, les ex-colonies anglaises ont démantelé leur zone monétaire commune pour mener des politiques monétaires souveraines et autonomes. En revanche, dans la zone franc, seuls quelques pays en ont fait de même : la Guinée, la Mauritanie, Madagascar, le Mali (provisoirement), l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Les pays qui ont choisi de demeurer dans le giron de la France en conservant leur monnaie unique, le Franc CFA, sont : Djibouti, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo, la Côte-d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La Guinée Equatoriale et la Guinée-Bissau se sont jointes à eux. La France a doté cette monnaie d’une convertibilité qu’elle s’est engagée à garantir sous réserve de la rétention de tout ou partie des avoirs extérieurs en devises de ces pays dans un « compte d’opération » ouvert auprès du Trésor Public français par les banques centrales de la zone franc : la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) . La France s’est également arrogée un droit de veto dans la gestion de ces banques centrales. De même, tout changement des règles du jeu au sein de la zone monétaire francophone nécessite un accord préalable avec la France. On devine aisément les implications qui s’attachent au corset ainsi créé quand on connaît l’importance de la monnaie dans la marche d’une économie. Celle-ci a, en effet, trois fonctions traditionnelles. Elle est, d’abord, une unité de compte, ensuite un moyen de paiement et enfin un instrument de réserve. Son émission ayant constitué de tout temps un droit régalien réservé aux seuls dirigeants des territoires indépendants, les détracteurs de la zone, qualifiant ces accords monétaires de relique coloniale, ont demandé leur abrogation. Les tenants du système, quant à eux, pour justifier le maintien du franc CFA, arguent du privilège de disposer d’une monnaie unique convertible et la capacité des pays de la zone à satisfaire les trois critères sur lesquels doit reposer une politique monétaire durable, à savoir la stabilité interne et externe et la croissance économique. Tout Etat réglemente comme il l’entend la sortie de sa monnaie nationale et l’entrée des monnaies étrangères sur son territoire par le biais de sa politique de change, sa monnaie pouvant être transférable, c’est-à-dire convertible sur le marché international des changes. La convertibilité d’une monnaie réside dans sa capacité à être échangée contre une autre devise. Par exemple, des dollars peuvent s’échanger contre des euros et vice versa. Ces monnaies sont convertibles entre elles et cette convertibilité signifie que les banques centrales qui les ont émises s’engagent à les racheter. Lorsqu’une monnaie est convertible, le gouvernement qui l’émet en autorise la sortie. C’est généralement le cas des pays développés à économie de marché. La convertibilité n’exclut pas l’existence d’un contrôle des changes plus ou moins coercitif, en particulier pour les résidents qui peuvent être sujets à des restrictions dans l’usage des monnaies étrangères et dans les montants qu’ils peuvent transférer. C’est le cas du franc CFA dont la convertibilité est restreinte à l’euro et le libre transfert à la France. Le franc CFA, monnaie commune, est supposé contribuer à une plus grande transparence des prix, à l’élimination des distorsions liées au risque de change entre monnaies nationales et de frais bancaires inutiles. Son objectif théorique est aussi de créer une discipline monétaire et budgétaire saine. Cette monnaie devait assurer à la fois une stabilité des prix, une absence de dévaluations compétitives entre pays membres de l’union monétaire et l’obtention de taux d’intérêt réels bas et stables favorables à la croissance et à l’emploi. Mais, force est de constater que la convertibilité et le libre transfert du franc CFA favorisent une sortie massive des capitaux à travers le transfert, sans risque de change des bénéfices des entreprises du secteur privé, françaises dans leur très grande majorité. Elle encourage également l’exode des revenus des ménages expatriés vers leur pays d’origine. Ces flux monétaires et commerciaux qui passent tous par le filtre des banques centrales ont pour seule destination l’Hexagone. C’est le cas depuis la mise en place, en 1993, du régime de contrôle de change par la France. Entre 1970 et 1993, le rapatriement des bénéfices et des revenus d’expatriés s’est élevé à 6,3 milliards de dollars alors que les investissements étrangers s’élevaient à 1,7 milliards de dollars. Les rapatriements ont donc été quatre fois supérieurs aux investissements. De même, anticipant une dévaluation qui était devenue inéluctable eu égard à la détérioration des comptes dans les années 1990 et le refus de la France de soutenir les budgets africains, les placements spéculatifs effectués en francs CFA en France entre janvier 1990 et juin 1993 s’étaient élevés à 928,75 milliards de francs CFA soit environ 1,416 milliards d’euros . De surcroît, en contrepartie de la garantie de convertibilité du CFA, d’abord en franc français puis en euro, la France exige depuis 1960 que les pays de la zone déposent leurs réserves de change sur un compte du Trésor Public français. A l’aube des indépendances le dépôt exigé était de 100%. Il a été réduit à 65% en 1973, puis plafonné à 50% depuis septembre 2005, le reliquat devant servir au remboursement de la dette extérieure des pays membres. Mais, hormis les « gourous » des finances françaises, nul ne sait ce que recèle en réalité ce compte d’opérations et ce que la France fait des très importantes sommes qui y sont déposées. D’après la convention sur ce compte, signée en 1962 entre le ministère français de l’Économie et ses ex-colonies membres de la zone franc, le Trésor français perçoit, en cas de découvert, des agios payés par les banques centrales. En revanche, il leur verse des intérêts si les comptes sont créditeurs. Depuis la mise en œuvre des accords de coopération monétaire, le compte d’opération n’a été débiteur temporairement qu’à cinq reprises depuis 1973, le solde étant créditeur de manière ininterrompue depuis janvier 1994. Le rapport 2005 de la zone Franc montre que les banques centrales détiennent des records de réserves au Trésor français estimées à 6300 milliards de FCFA, équivalents à 9,6 milliards d’euros soit un taux de couverture de l’émission monétaire supérieur à 110 %, alors que la convention de 1962 n’exige qu’un taux de couverture de 20 %. Entre janvier et décembre 2006, les avoirs extérieurs nets de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest avaient progressé de 544,3 milliards de F CFA (830 millions d’euros) pour se situer à 3 710 milliards de F CFA (5,7 milliards d’euros). Sur la même période, ceux de la Banque des Etats de l’Afrique centrale avaient augmenté de 1757 milliards (2,7 milliards d’euros) pour atteindre 4382 milliards de FCFA (6,7 milliards d’euros). Les pays membres de la zone franc, dont certains sont classés parmi les plus pauvres du monde, selon leur indice de développement, se voient ainsi privés par la France d’énormes ressources financières qui auraient pu être investies dans les secteurs clés de leurs économies (production vivrière, éducation, santé, logements et infrastructures). Le plus révoltant dans ce marché de dupes est que la France se sert de l’argent de ces pays pour leur concéder des prêts à des taux prohibitifs. Le comble est que les pays de la zone, non contents de se voir amputer d’une part importante de leurs revenus, s’endettent auprès de la Banque Mondiale et du FMI aux conditions drastiques que l’on sait au lieu d’user de leurs propres avoirs confisqués par la France. En se comportant comme des victimes consentantes, lesdits pays n’ont fait que traduire une attitude éminemment freudienne des Noirs qui confine à l’auto-flagellation. En ce qui concerne la stabilité interne de la zone franc, le rattachement du franc CFA au franc Français et aujourd’hui à l’euro était censé permettre aux autorités monétaires de la zone franc d’imposer la discipline anti-inflationniste de la Banque de France et maintenant de la Banque européenne. La zone s’est toutefois révélée impuissante à contrecarrer la flambée des prix du pétrole, des matières premières et des denrées alimentaires provoquées en partie, par la progression de la demande des Asiatiques en matières premières, particulièrement des Chinois. L’augmentation des prix des denrées alimentaires a donné naissance à des émeutes de la faim dans nombre de pays d’Afrique parmi lesquels figurent des pays de la zone franc tels que la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso et le Sénégal. Quant à la stabilité externe, c’est à dire la stabilité d’une monnaie sur les marchés des changes, elle est étroitement liée à la politique de change qui la sous-tend. Les pays de la zone franc ont opté pour une politique de taux de change fixe alors que le taux de change de l’euro sur lequel il est arrimé est flottant et ne cesse de s’apprécier . La politique d’un euro fort et de taux d’intérêts élevés poursuivie par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour juguler tout risque d’inflation et attirer les capitaux étrangers en Europe prive les pays de la zone franc de compétitivité. Le franc CFA est surévalué par rapport aux autres monnaies des pays du Sud avec lesquels il est en concurrence. Les produits libellés en FCFA deviennent trop chers et les pays de la zone se retrouvent ainsi exclus des marchés du Sud. La politique d’un euro fort est préjudiciable aux économies de la zone franc comme l’a été auparavant la politique d’un franc fort menée par l’ex ministre de l’économie et des finances, Pierre Bérégovoy, sous le gouvernement socialiste de François Mitterrand. L’appréciation de l’euro par rapport au dollar ruine les économies des pays de la zone Franc. De janvier 1999 à mai 2008, l’euro est passé de 1,17 à 1,59 dollars, ce qui signifie que le franc CFA, monnaie des économies jugées parmi les plus indigentes du monde, s’apprécie par rapport au billet vert. Cela ne manque pas de poser problème, car les prix des principaux produits d’exportation de la zone comme le café, le cacao et le coton sont libellés en dollars, tandis que ceux de leurs plus gros volumes d’importation le sont en euros. En effet, se faire payer ses exportations en monnaie faible et régler ses importations en monnaie forte ne peut que provoquer une incidence négative très handicapante sur les balances commerciales, au point que la question d’une nouvelle dévaluation du franc CFA, à seule fin d’accroître artificiellement la compétitivité des exportations de la zone franc, se pose à nouveau. Quel contraste avec la Chine qui, depuis le 1er Janvier 1994, a ancré sa monnaie, le yuan, au dollar à un taux de change extrêmement bas, ce qui lui donne un avantage compétitif par rapport à ses concurrents occidentaux et des possibilités d’exportation accrues. La zone franc a également été promue comme étant un espace propice à la croissance économique de ses membres. La croissance économique est sujette au niveau des taux d’intérêt et des liquidités mises en circulation par la Banque centrale, au volume des investissements et des échanges commerciaux. La masse monétaire en circulation dans la zone franc se mesure à l’aune des seuls échanges entre la France et ses alliés africains, aux transferts des travailleurs émigrés, au rapatriement des capitaux spéculatifs et aux décaissements des bailleurs de fonds. Dans un tel contexte, les taux d’intérêt demeurent toujours élevés. Leur haut niveau est préjudiciable à tout essor économique et prive les entrepreneurs de ces pays des crédits bon marché sans lesquels il n’y a point d’existence pour les petites et moyennes entreprises ni de classe moyenne vecteur de développement. La convertibilité du franc CFA et son arrimage à l’euro éliminant tout risque de change entre les zones franc et euro, cela était censé faciliter l’afflux des investissements productifs créateurs d’emplois en provenance d’Europe. En réalité, les investissements dont ont bénéficié les pays d’Afrique se sont portés quasi exclusivement dans l’exploitation des ressources naturelles. Les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique ont atteint 38 milliards de dollars US en 2007 contre 126 milliards de dollars en Amérique latine et aux Caraïbes, 224 milliards de dollars pour les pays d’Asie du sud et d’Océanie, 98 milliards de dollars pour les pays de l’Europe du sud-est et de la Communauté des États Indépendants (CEI). Durant la période 2002 - 2004, les IDE en Afrique avaient seulement été de 1,2 milliards de dollars . L’accroissement enregistré est essentiellement du aux investissements en provenance des pays émergents d´Asie : Hong Kong, République de Corée, Chine, Inde et Malaisie et non d’Europe. Ils sont concentrés dans les industries extractives et ne bénéficient qu’à un nombre limité de pays tels que le Nigeria, l’Angola, le Mozambique, le Soudan, le Congo Brazzaville, la Guinée Equatoriale ou la République démocratique du Congo. Ces investissements dans l’exploitation des ressources naturelles, particulièrement le pétrole et les minerais, perpétuent la dépendance de la région et son appauvrissement résultant d’une exploitation systématique de ses ressources sans la contrepartie d’investissements productifs, de créations d’emplois et d’exportations de biens manufacturés. Il en est de même des flux commerciaux entre les pays de la zone franc et ceux du reste du monde qui se réduisent à l’importation de produits manufacturés et à l’exportation de produits de base, ce qui exclut tout développement industriel autonome. Ceci devrait inciter les Africains à promouvoir la diversification des investissements, à renforcer leurs capacités productives dans leurs autres secteurs économiques et à développer un espace légal régissant les partenariats entre les filiales étrangères et les entreprises locales pour favoriser le transfert de la technologie dont la région a besoin pour s’industrialiser. L’existence d’un marché unique dépourvu de barrières commerciales ou financières et d’entraves à la libre circulation des biens et des capitaux sont les conditions sine qua non pour tirer le maximum de bénéfices d’une monnaie unique. Pourtant, ce marché unique dans lequel les pays de la zone franc sont supposés évoluer n’a d’existence que de nom. Ils en sont encore, depuis prés de deux décennies, à s’échiner à mettre en place une union douanière au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), les deux organisations chargées de la mise en place de l’harmonisation des régimes fiscaux et des politiques de convergence économique de leurs membres. Il faut se souvenir que de 1945 à 1960, la coopération monétaire et la coordination des politiques économiques avec la France, dans le cadre de la zone franc, s’étaient en effet appuyées sur une intégration politique, économique et monétaire complète ainsi qu’une libre circulation des personnes, des biens et des services. Le choix des pays africains qui ont décidé de rester sous la tutelle monétaire de la France aurait donc été justifié si ces mêmes pays avaient maintenu le marché commun et les structures fédérales dans lesquels ils opéraient sous le régime colonial. Mais ils n’en ont rien fait. Bien au contraire, ils se sont employés à les démanteler dès leur accession à l’indépendance. En érigeant des barrières douanières entre eux, les Africains se sont délibérément coupés les uns des autres, créant de facto un environnement économique impropre à l’adoption d’une monnaie unique. De plus, les banques centrales de la zone franc n’ont aucune existence juridique sur le marché des changes, Il revient donc à la Banque Centrale européenne (BCE), qui a hérité des accords franco-africains, d’agir en leurs noms. Mais quand la BCE intervient sur le marché international des devises c’est pour défendre l’euro et non le FCFA. Cette sous-traitance de la gestion du franc CFA à la BCE constitue un frein supplémentaire au processus d’intégration des économies des pays de la zone et à l’accroissement de leurs échanges intra-communautaires. Dans ces circonstances, il y a quelque chose de kafkaïen dans cette démarche qui consiste à démanteler des structures pour ensuite essayer de les remettre en place à rebours. Cela engendre des distorsions structurelles, institutionnelles et économiques dont les dirigeants et les élites francophones d’Afrique noire n’ont cure, d’autant qu’ils en tirent des intérêts personnels. En effet, la convertibilité du FCFA est un moyen bien commode pour eux de disposer de fortunes considérables et d’immenses domaines immobiliers dans l’Hexagone. Les crises économiques et financières qui affectent les pays de la zone franc depuis les années 1990 sont les manifestations les plus éloquentes de l’échec des politiques et des choix qui ont prévalu en son sein. Elles ont conduit à la dévaluation de 100% du franc CFA en janvier 1994 et à la paupérisation qui a conduit aux désordres que l’on sait et qui vont aller s’aggravant à moins que l’on mette fin au système d’exploitation institutionnalisée que représente la zone franc. En l’état actuel du développement des économies africaines, la norme, en matière de politique de change devrait reposer sur l’inconvertibilité et l’intransférabilité des monnaies nationales. Lorsqu’un Etat interdit la sortie de sa monnaie nationale, cette monnaie est dite non convertible donc non transférable. Dans ce cas, un contrôle des changes hermétique donne le monopôle des monnaies étrangères aux autorités monétaires qui contrôlent toutes les opérations de change avec l’extérieur. Cette restriction légale assure une gestion rigoureuse des rentrées et des sorties de devises, ce qui permet de les allouer en priorité au développement des secteurs clé des économies concernées. Cette situation est d’ailleurs fréquente dans le monde en particulier dans les pays en voie de développement (PED) très déficitaires qui connaissent de graves difficultés de paiements. C’est également le cas des économies régulées de type semi-étatique où l’Etat prend en charge le contrôle des secteurs essentiels de l’économie comme en Chine, en Inde ou au Vietnam. Rappelons également que pendant longtemps l’échange de francs français contre des devises n’était pas libre mais réglementé. Une convertibilité externe du franc, rétablie en 1958 pour les non-résidents, n’était pas totale pour les résidents. Par exemple, ceux-ci ne pouvaient pas sortir des capitaux hors des frontières sans autorisation administrative. Quant au géant chinois, soucieux de ne pas faire peser des risques importants sur sa croissance économique par une sortie incontrôlée de devises, il n’autorise pas la libéralisation de son marché des changes et sa monnaie, le yuan, n’est pas librement convertible. Au vu de ce qui précède, les avantages avancés pour le maintien de la convertibilité du franc CFA se révèlent être un subterfuge qui institutionnalise l’appauvrissement socio-économique des pays de la zone franc. Ils se doivent d’y mettre fin, de recouvrer la gestion de leurs réserves de change, d’instituer un strict régime de contrôle change et d’étendre les politiques d’harmonisation fiscale et de convergence économique qu’ils mènent au sein de l’UEMOA et de la CEMAC à l’ensemble des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’organisation mandatée par l’Union Africaine (UA) pour coordonner les politiques d’intégration dans la sous-région. *Sanou Mbaye, économiste, ancien fonctionnaire international, auteur de l’Afrique au secours de l’Afrique, à paraitre en janvier 2009 aux Editions de l’Atelier. |
%20(Large).JPG) Christian Bouquet a mis les pieds dans le plat du débat politique ivoirien, en révélant la volonté de certains acteurs politiques ivoiriens, de bloquer le processus de paix. Parlant du chef de l’Etat ivoirien, ce politologue français a révélé qu’il n’ira à des élections que s’il est convaincu de pouvoir les remporter. « Gbagbo ira à des élections tant qu’il sera certain de les remporter », a-t-il indiqué sur Rfi. Au dire de Christian Bouquet, depuis les dernières élections présidentielles, les tendances ont bougé, parce que les rapports de force ont beaucoup évolué sur le terrain. Mais, a-t-il tempéré, « il semble d’après les analystes que la ligne a assez peu bougé et on pense que les indications qui étaient sorties des municipales 2001, ne seront pas très loin de ce qui pourraient sortir du scrutin présidentiel 2009, si les élections sont justes, équitables et normalement organisées ». En clair, selon Bouquet, les résultats des prochaines élections présidentielles ne seront pas loin de ceux des municipales, si tout se passe bien. Cependant, s’est-il montré pessimiste , sachant qu’un acteur de poids va perdre, il faut craindre à l’horizon des difficultés. « C’est ce qui fait toute la fragilité du système. Au moment où le chef de l’Etat va comprendre qu’il va perdre, alors il est possible que des grains de sable s’insinuent dans le processus », a-t-il analysé. Christian Bouquet a dédouané les acteurs politiques ivoiriens accusés de faire perdurer la crise ivoirienne, et qui avaient promis d’organiser les élections le 30 novembre dernier. « C’était une promesse difficile à tenir dans la mesure où il fallait passer par tout le processus long et compliqué. Techniquement, il y avait beaucoup de choses à mettre en place, il n’y avait pas mal d’argent à trouver. Et puis il y avait une partie des acteurs qui freinaient un peu le processus, tandis que d’autres avaient voulu que ça aille plus vite », a-t-il ajouté. Non sans indexer les gens qui sont au pouvoir, et qui craignent de le perdre et qui livrent des combats d’arrière-garde sur la question du désarmement avant les élections. « Les gens qui sont au pouvoir, peuvent craindre de le perdre, alors on assiste à des combats d’arrière-garde de la part des gens au pouvoir, le FPI en particulier qui voudrait le désarmement avant les élections... », a-t-il précisé. Même si la communauté internationale, à en croire le politologue français, est mise en veilleuse par les acteurs de la crise ivoirienne, il n’empêche qu’elle est présente pour la validation des étapes du processus électoral. « C’est vrai que ce sont les Ivoiriens qui sont maîtres chez eux dans la gestion du processus électoral, mais il est quand même placé sous surveillance étroite de l’Onuci », a conclu Christian Bouquet.
Christian Bouquet a mis les pieds dans le plat du débat politique ivoirien, en révélant la volonté de certains acteurs politiques ivoiriens, de bloquer le processus de paix. Parlant du chef de l’Etat ivoirien, ce politologue français a révélé qu’il n’ira à des élections que s’il est convaincu de pouvoir les remporter. « Gbagbo ira à des élections tant qu’il sera certain de les remporter », a-t-il indiqué sur Rfi. Au dire de Christian Bouquet, depuis les dernières élections présidentielles, les tendances ont bougé, parce que les rapports de force ont beaucoup évolué sur le terrain. Mais, a-t-il tempéré, « il semble d’après les analystes que la ligne a assez peu bougé et on pense que les indications qui étaient sorties des municipales 2001, ne seront pas très loin de ce qui pourraient sortir du scrutin présidentiel 2009, si les élections sont justes, équitables et normalement organisées ». En clair, selon Bouquet, les résultats des prochaines élections présidentielles ne seront pas loin de ceux des municipales, si tout se passe bien. Cependant, s’est-il montré pessimiste , sachant qu’un acteur de poids va perdre, il faut craindre à l’horizon des difficultés. « C’est ce qui fait toute la fragilité du système. Au moment où le chef de l’Etat va comprendre qu’il va perdre, alors il est possible que des grains de sable s’insinuent dans le processus », a-t-il analysé. Christian Bouquet a dédouané les acteurs politiques ivoiriens accusés de faire perdurer la crise ivoirienne, et qui avaient promis d’organiser les élections le 30 novembre dernier. « C’était une promesse difficile à tenir dans la mesure où il fallait passer par tout le processus long et compliqué. Techniquement, il y avait beaucoup de choses à mettre en place, il n’y avait pas mal d’argent à trouver. Et puis il y avait une partie des acteurs qui freinaient un peu le processus, tandis que d’autres avaient voulu que ça aille plus vite », a-t-il ajouté. Non sans indexer les gens qui sont au pouvoir, et qui craignent de le perdre et qui livrent des combats d’arrière-garde sur la question du désarmement avant les élections. « Les gens qui sont au pouvoir, peuvent craindre de le perdre, alors on assiste à des combats d’arrière-garde de la part des gens au pouvoir, le FPI en particulier qui voudrait le désarmement avant les élections... », a-t-il précisé. Même si la communauté internationale, à en croire le politologue français, est mise en veilleuse par les acteurs de la crise ivoirienne, il n’empêche qu’elle est présente pour la validation des étapes du processus électoral. « C’est vrai que ce sont les Ivoiriens qui sont maîtres chez eux dans la gestion du processus électoral, mais il est quand même placé sous surveillance étroite de l’Onuci », a conclu Christian Bouquet..jpg)




.jpg)




.JPG)

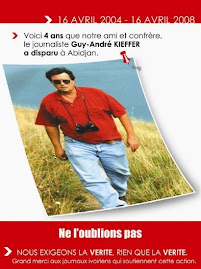.jpg)